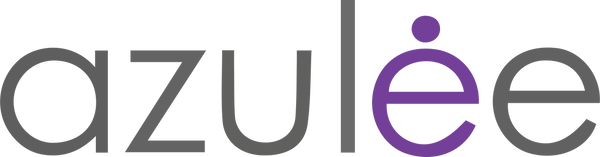visite autoguidée
Notre visite autoguidée vous permet d'explorer et de découvrir notre maison ancestrale, notre environnement au bas de la baie, un peu d'histoire locale et une multitude de choses à découvrir en parcourant notre petit champ. N'hésitez pas à nous contacter avant votre visite pour toute question ! Notre boutique est toujours ouverte à tous.
La belle fermette
En quittant la boutique extérieure, longez la façade de la maison en direction du fleuve et tournez à droite au bout du balcon. Suivez ensuite les indications. Des balises rondes et numérotées, peintes du même vert poétique que la maison, correspondent aux sections numérotées de cette visite autoguidée ; et des flèches vertes indiquent le chemin jusqu'à la prochaine étape. Profitez de l'air marin !
En chemin, remarquez que les façades de la maison principale et de sa cuisine d'été sont symétriques, avec une porte au centre et des fenêtres à espacement identique de chaque côté. Les lucarnes du deuxième étage sont également disposées symétriquement. Cette symétrie est caractéristique des maisons de ferme néoclassiques du Québec. Ce style est également connu pour son toit à pignon à forte pente et ses avant-toits évasés. L'absence de cette partie évasée du toit rend notre maison unique dans Charlevoix et au Québec.
Nous nous estimons très chanceux d'avoir acquis cette maison de M. Louis-Philippe Filion, de Baie-Saint-Paul. Construite en 1844 par la famille Tremblay, elle fut cédée par mariage à la famille Filion vers 1888 ; elle demeura leur demeure ancestrale jusqu'à son acquisition par Louise et Parker en 2002.
Construite en rondins taillés à la main sur deux faces, cette technique de construction traditionnelle « pièce en pièce » se caractérise par des joints en queue d'aronde dans les coins et des larges poutres en cèdre qui s'étendent sur toute la largeur de la maison. Notre maison a connu plusieurs modifications au fil du temps. Elle a été agrandie à plusieurs reprises au fur et à mesure que la famille s'agrandissait, et la cuisine d'été, ajoutée ultérieurement, a connu au moins trois modèles de toiture différents. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus, à l'intérieur comme à l'extérieur, d'un ciment semblable à du stucco – encore visible sur des photographies de 1947 – et les encadrements des fenêtres et des portes étaient larges et ouvragés. Faute de lattis métalliques à l'époque, on faisait travailler les enfants à enfoncer des milliers de petits coins de bois dur dans les rondins pour maintenir le stucco. Le bardage en gorge que l'on voit aujourd'hui a probablement été ajouté à la fin des années 1940 ou 1950, lorsque ses moulures ornementées ont été remplacées par des moulures simples. À l’intérieur de la maison principale le ciment a été recouvert de pin en gorge mais les encadrements de fenêtres et de portes ornementés d'origine ont été conservés. La toiture d'origine en bardeaux de cèdre a été remplacée par de l'aluminium ondulé dans les années 1970.
Notre belle vieille maison a toujours besoin de réparations et d’entretien – un projet sans fin !

Point no. 1 - Notre Environnement
En regardant vers le Saint-Laurent, en face de la maison, vous apercevrez le confluent des rivières du Milieu et du Moulin, qui se jettent dans l'estuaire, sous le pont ferroviaire. Les plus hautes marées à Baie-Saint-Paul atteignent environ 7 m (22 pi) et, lorsqu'elles montent l'autre côté de la rue, la zone se transforme en marais salant. En été, une dizaine de fois par mois, nous pouvons traverser la rue, sauter dans notre petite embarcation et partir à la conquête du large !

Au-delà du pont, on aperçoit sur toute sa longueur l'Isle-aux-Coudres, baptisée par Jacques Cartier qui y découvrit une abondance de noisetiers sauvages (appelés coudriers)... Faire le tour de l'île à vélo ou en voiture est une aventure amusante, et le traversier est gratuite à partir de St-Joseph-de-la-Rive.
Le chemin de fer a été construit environ 50 ans après notre maison. On peut facilement imaginer la vue du fleuve avant son arrivée ! Pendant des siècles, toutes les marchandises voyageaient de village en village le long du fleuve, sur des goélettes à fond plat, à deux ou trois mâts. Dans le hameau voisin de Saint-Joseph-de-la-Rive, vous pouvez visiter le Musée maritime de Charlevoix. Ses cales sèches abritent des navires à explorer, et ses expositions instructives attirent les amoureux de la mer et les aventuriers de tous horizons !
En 2009, des fouilles archéologiques ont été menées de l'autre côté du marais, à gauche du pont ferroviaire. La personne qui a rédigé son mémoire de maîtrise sur les découvertes à cet endroit a apporté un éclairage remarquable sur les débuts de Baie-Saint-Paul. L'étoile lavande sur la photo ci-dessous identifie l'emplacement des fouilles, où ont été mis au jour les vestiges de deux bâtiments. Il s'agissait des premier et deuxième établissements européens à Baie-Saint-Paul, établis à l'extrémité est de la vaste seigneurie de Beaupré.
La première, qui abritait deux maîtres goudronniers, fut construite en 1653. À l'époque, la colline derrière notre maison était densément couverte de pins rouges, une source idéale de poix utilisée pour colmater les brèches des navires avant leur retour en France. Le roi Louis XV leur avait accordé le droit exclusif de produire du goudron en son nom.
Après cinq ans, il ne restait que très peu de pins rouges à récolter, et le seigneur de Beaupré leur demanda de quitter les lieux pour faire place à l'une des trois premières fermes familiales de BSP. Les nouveaux arrivants brûlèrent la maison des goudronniers et construisirent leur maison presque au même endroit, qui devint la « ferme du bas de la Baie ». Aujourd'hui encore, les habitants appellent notre petit coin de Baie-Saint-Paul « le bas de la Baie ».

La transcription complète de la thèse zooarchéologique est disponible ici.
À environ 150 m sur la route se trouve la rivière du Moulin où la première scierie de la région a été construite vers 1685. Le site abritait au moins trois moulins, dont deux scieries et un moulin à farine qui a ensuite été transformé en usine textile.
Ceci complète notre petit aperçu de l'histoire de notre coin de Baie-Saint-Paul. Si cela a piqué votre curiosité, notre petite ville est très riche en histoire (réf. : Centre culturel Paul-Médéric) ; de plus, Charlevoix compte plusieurs musées, un centre d'archives et des lieux d'interprétation fascinants.
Notre lavande biologique est en très bonne compagnie à Baie-Saint-Paul, une ville parsemée d'entreprises agroalimentaires même en périphérie urbaine. Son mélange unique de zones résidentielles et agricoles ajoute à son charme. Azulée est également membre de la Table agrotouristique de Charlevoix et fait partie de sa Route des Saveurs. Notre lavande biologique, nos fines herbes fraîches et séchées et autres mini-cultures se retrouvent dans de nombreux plats chez les restaurateurs locaux… de la rue Saint-Jean-Baptiste, au centre-ville et jusqu'à La Malbaie.
En 2015, Louise remporte le Prix du patrimoine régional, dans la catégorie « Préservation et Mise en valeur du territoire ».
Pourquoi la lavande bio ? Pour le bien de notre environnement et pour favoriser les cultures peu gourmandes en eau, ce petit arbuste s'épanouit dans les sols pauvres, avec très peu d'eau ! Depuis 2014, le projet se développe petit à petit, grâce à la contribution magique d'une multitude de petits lutins toujours dévoués !
Point no. 2 - Le jardin du coin

Nos jardins comestibles biologiques abritent de nombreuses petites merveilles !

Au point 2, à droite, vous trouverez de la sarriette d'été, de la sauge, de la lavande de Munstead, du persil frisé et enfin de l'achillée millefeuille. L'immense plante à l'extrême droite est la livèche (cousine du céleri), et à côté, l'achillée millefeuille. Le pourtour est bordé de mini-œillets comestibles. N'oubliez pas d'admirer le rosier rouge, derrière l'allium purpureum (oignon ornemental).

Devant vous, à gauche, se trouvent quatre petits parterres rectangulaires plantés de (1) rhubarbe rouge bio, (2) de mélisse bio pour notre tisane Estelle, (3) camomille bio dont nous ne récoltons que les fleurs pour une tisane délicieusement relaxante, et enfin (4) oseille, dont la saveur citronnée d'épinards est délicieuse avec du saumon. L'oseille existe depuis des siècles – comme toutes ces plantes anciennes d'ailleurs – et elle est excellente dans les soupes ou comme garniture pour les spanakopitas à la feta maison.


Sur le chemin du point 3, vous verrez un petit prunier bio, de la sauge de Russie, d'autres rhubarbes rouges bio et notre pépinière de jeunes lavandes de Munstead. Nos plants y sont cultivés pour être vendus au public au printemps suivant, ou pour remplacer ceux du champ qui n'ont pas résisté aux intempéries du Pépère Hiver ou… de Dame Nature. Les derniers parterres de fleurs abritent des spécimens de monarde : ses feuilles séchées sont délicieuses en tisane (bergamote), d'autres jeunes plants de lavande et de l'ail des ours, planté à l'automne pour être récolté l'été suivant. Nous changeons constamment nos plantations !
Suspendus aux trois anciens poteaux téléphoniques Bell, nos houblons biologiques Willamette. Ces vignes s'adaptent bien à la zone horticole 3b, elles aiment l'eau et leurs racines creusent jusqu'à 4,5 mètres de profondeur pour la trouver. Les cônes de houblon sont récoltés fin août, lorsqu'une fine poudre jaune apparaît à leur base. En plus d'être utilisé pour brasser de la bière, le houblon est apprécié en tisane, ce qui favorise la production de lait maternel chez les mères qui ont des nouveau-nés !


Point no. 3 – Notre champ de lavande
Notre lavande, lavandula angustifolia, ou lavande anglaise, a comme nom commun lavande vraie. La plupart de nos plantes appartiennent à la variété Munstead, appréciée en cuisine pour sa saveur plus douce et sa faible teneur en camphre, tout en étant adaptée à notre climat. En passant vos doigts sur leurs feuilles, vous pourrez sentir l'huile essentielle, même sans fleurs !


Le rêve de Louise d'avoir un champ de lavande dans son jardin a commencé à se réaliser fin 2013. Le travail de Parker au Yukon a pris fin à l'automne, et Louise est revenue d'Ontario où leur fils Max étudiait à l'université. Un drainage agricole a été installé sous le sol. Le champ a été labouré, puis monté en rangs surélevés. La charrue spécialement conçue à cet effet est visible près de l'entrée supérieure du champ.
Le jardin carré (que nous aborderons bientôt) avait hiverné plus d'une centaine de semis. Au printemps 2014, ils ont été transplantés dans les rangs surélevés. Au total, 19 rangs ont été formés et plantés avec près de 1 400 semis la première année. Au cours des années suivantes, les autres rangs ont été formés et plantés avec des centaines d'autres ; les pépinières ont été créées par la suite.
Sur une pente douce, le champ est bien drainé grâce à un drain français qui traverse le bas de la plantation. Attention à cet aspect important de la culture de la lavande : cette plante déteste avoir les pieds mouillés. Le champ doit donc être conçu pour un bon drainage du sol, afin d'éviter la mort subite et… les maladies.
Nous gardons nos plants à l'état juvénile pendant leur premier été ; autrement dit, nous les empêchons de fleurir, ce qui favorise le développement des racines. Notre première récolte a donc eu lieu en 2015, année de l'apparition de la lavande azulée, fièrement certifiée biologique par Ecocert Canada. Si tout se passe bien, un plant de lavande vit environ dix ans dans nos conditions. En plantant sur plusieurs années, nous assurons la pérennité de notre micro-entreprise.
Le 1er mai 2023, nous avons été frappés par une violente tempête qui a déversé plus de 110 mm de pluie en très peu de temps. Le sol n'avait pas encore dégelé, et les conséquences ont été désastreuses pour notre petit champ. Au total, nous avons perdu environ un quart de nos 2 000 plants, le reste étant affecté à des degrés divers. Nous avons vidé un quart du champ en déplaçant les plants survivants pour remplacer les plants morts enlevés ailleurs, puis nous avons entrepris d'améliorer le drainage. Nous essayons toujours de l'améliorer !
L'année dernière, nous avons replanté la partie vidée du champ. La serriste biologique qui nous fournit les plants rencontrait des difficultés à produire la quantité de plants de Munstead que nous avions commandée ; elle a donc compensé avec une autre variété, Phenomenal. Celle-ci n'a pas apprécié nos conditions et un grand nombre est mort de pourriture des racines. Celles qui ont survécu ont été déplacées (voir point 4) et cette section a été transplantée avec une nouvelle variété d'Angustifolia, Super Blue. Nous lui souhaitons bonne chance !
Point no. 4 – Plantations expérimentales
L'espace en haut du champ était, jusqu'à récemment, la haie de tournesols géants de Parker. Elle faisait toujours le bonheur des visiteurs, mais malheureusement, une maladie tenace s'est installée et la haie a disparu ! Cette année, une grande partie du massif est plantée de deux variétés de sauge – tricolore et commune – l'idée étant que la récolte soit versée dans l'alambic de Parker à la fin de l'été. Parker prévoit d'utiliser l'huile obtenue dans un nouveau produit, à suivre… L'extrémité gauche de la parterre abrite un lavandin (hybride de lavande) nommé Phenomenal, connu pour sa forte production d'huile. Nous l'avions planté dans le champ l'été dernier, mais il n'a pas eu de bons résultats. Les quelques plants qui ont survécu ont été récemment transplantés ici, une zone très bien drainée. Les autres plants sont une autre variété de Lavandula Angustifolia, Super Blue. C'est un hybride récemment développé qui devrait s'épanouir dans nos conditions. Quelques graines de tournesol ont réussi à germer, et nous les avons laissées faire ! Nous ne savions pas s'il s'agissait de la variété géante ou mini au moment de la rédaction de cet article, mais cela devrait bientôt devenir évident !
Point no. 5 - Notre jardin carré à gauche
Louise a créé son premier jardin d'herbes aromatiques ici en 2003. Il était carré et entouré d'une palissade blanche qui servait à dissuader les petites créatures, sauvages ou moins sauvages, d'y pénétrer. Depuis, le séchoir a été construit et le jardin est en perpétuelle évolution.
On y trouve des tomates cerises biologiques, de l'origan du Québec, de la ciboulette dite « à feuilles plates » (ses petites fleurs blanches satellites sont délicieuses en garniture sur les sautés, les salades, etc.), de la ciboulette et du raifort. Les racines de raifort râpées accompagnent délicieusement les viandes rouges et relèvent la salade de chou, tandis que ses jeunes feuilles tendres, coupées en julienne, sont un excellent ajout aux salades d'été.

Derrière, un grand buisson d'estragon bio se dresse, et à proximité, des rudbeckies.
Au printemps, de gros bulbes blancs et bleus flottent au vent : ce sont les alliums Gladiator et Everest.
À vous maintenant de trouver le thym ! Tous ces produits sont certifiés biologiques par Ecocert Canada.

Point no. 6 - Notre jardin rectangulaire à Droite

Au fil du temps, Louise a tenté de propager les lupins sauvages que vous voyez ici, récoltant les gousses et partageant les graines et les plants avec ceux qui les aiment aussi ! Les lupins étaient sur la liste des espèces menacées au Québec. De plus, la verveine citronnée peut être dégustée en tisane et utilisée pour préparer un sirop pour les cocktails d'été ou le glaçage des cupcakes. Nous en fournissons également à Hydromel Charlevoix, rue Saint-Jean-Baptiste. L'hydromel est une boisson alcoolisée à base de miel fermenté et d'eau, avec ou sans herbes aromatiques.
Notre verveine citronnée biologique est également présente dans un spiritueux signature de la Famille Dufour.


Près des asperges et de leur feuillage fin, on trouve de petits plants de faux curry, du romarin bio, encore de la verveine citronnée bio et de l'origan grec. Derrière, l'achillée millefeuille rose…

Ensuite, devant le gros rocher se dresse un joyeux groseillier. Très productif en juillet, son fruit rouge vif se transforme en une compote aux délicates notes de lavande, l'un des nombreux produits saisonniers éphémères préparés par Louise durant les mois d'été.
Point no. 7 – Le séchoir
Après la mi-juillet, la majeure partie de la lavande est récoltée à la main, en bouquets, puis suspendue à des chaînes verticales dans le séchoir. La légère brise du Saint-Laurent favorise la circulation de l'air nécessaire au séchage des capitules et, selon la météo, notre récolte met 4 à 5 jours à sécher. Elle est ensuite manipulée, transformée et entreposée conformément aux normes du MAPAQ et d'Ecocert Canada.

Lorsque Parker a construit le séchoir en 2016, son objectif était de reproduire les lignes de l'ancien poulailler – et nous pensons qu'il a réussi son coup ! L'intérieur est assez petit, surtout lorsqu'il est rempli de lavande !


La lavande culinaire bio représente environ 75 % de notre récolte annuelle, le reste étant destiné à la fabrication de sachets, de baumes à lèvres et de mini-coussins. Avant la pandémie, le séchoir servait également de boutique. La planche de grange provient d'une grange locale qui s'était effondrée sous le poids de la neige, tandis que les fenêtres ont été réutilisées : nous les avons trouvées au grenier. L'armoire rustique était un cadeau des Petites Franciscaines de Marie, qui aiment la lavande autant que nous, et le luminaire est un vieux joug monté sur un manche à balai, avec une touche Ikea : les abat-jour !

Point no. 8 – Appareil de distillation
En août 2019, Parker a acheté un alambic qui est devenu sa nouvelle vocation : le joyeux scientifique ! Lors de votre visite, vous le verrez peut-être travailler derrière la maison. C'est là qu'il produit nos hydrolats et huiles essentielles d'azulée biologiques, principalement à partir de fleurs de lavande et de jeunes feuilles de cèdre. Le procédé de distillation à la vapeur d'eau pour extraire les huiles essentielles et les hydrolats de plantes est utilisé depuis des siècles. C'est un procédé assez simple, mais comme Parker a découvert, il présente certaines complexités.

1 – Brûleur au propane à haute puissance
2 – Chaudière
3 – Tuyau de raccordement
4 – Pot d’alambic
5 – Condensateur
6 – Entrée d’eau
7 – Sortie d’eau
8 – Ampoule séparateur
Pour démarrer le processus, la chaudière (2) est remplie d’eau en quantité suffisante pour produire le nombre de lots souhaité pour la journée.
Le brûleur au propane (1) sous la chaudière est allumé et l'eau est portée au point d'ébullition, 100 ˚C.
La vapeur circule à travers le tuyau de raccordement (3) de la chaudière vers le fond du pot d'alambic (4) qui aura été rempli jusqu'au col avec de la matière végétale - imaginez combien de tiges de fleurs de lavande il faut pour remplir le pot d'alambic !!
Comme les huiles essentielles bouillent à une température inférieure à celle de l'eau, la vapeur, en traversant la matière végétale, cède une partie de sa chaleur pour évaporer l'huile essentielle. Elle évapore également les composants hydrosolubles et liposolubles de la plante, créant ainsi l'hydrolat. L'hydrolat est un coproduit de la distillation à la vapeur d'eau et constitue la majeure partie du liquide recueilli. Plus doux et plus léger que l'huile essentielle, il possède néanmoins de nombreuses propriétés bénéfiques similaires.
Lorsque la vapeur atteint le condensateur (5), elle se compose essentiellement de vapeur d'huile essentielle mélangée à de la vapeur d'hydrolat. Le condensateur est constitué d'un petit tube contenant la vapeur à l'intérieur d'un tube plus grand qui sert de chemise d'eau autour du tube de vapeur. L'eau froide entre par l'entrée d'eau (6) et sort par la sortie d'eau (7), entourant le tube de vapeur et condensant la vapeur à l'intérieur en liquide. Si tout se déroule comme prévu, aucune vapeur ne sort du condenseur, uniquement du liquide.
Ce liquide s'écoule dans l’ampoule séparateur (8). Cette ampoule a une fonction essentielle : séparer l'huile essentielle de l'hydrolat.
Si tout se déroule comme prévu, il faut compter entre 1 h 30 et 2 h pour traiter un lot, une fois que l'eau de la chaudière a atteint le point d'ébullition. Un lot produira environ 1,75 à 2 litres d'hydrolat et 15 à 30 ml (1 à 2 cuillères à soupe) d'huile essentielle ! On comprend alors pourquoi les huiles essentielles sont si chères !

Merci !
Parker tient à vous faire savoir que notre expérience terrain et tout ce qui séduit votre sens de l'esthétique chez Azulée sont le fruit du travail acharné de Louise, de ses palettes de couleurs et de sa main verte… sans oublier ses talents culinaires !

Merci de votre visite dans notre petite ferme de lavande biologique ! Revenez maintenant à notre cuisine d'été pour une dégustation gratuite et découvrir nos produits gourmands et relaxants, élaborés à base de lavande, de camomille, de verveine et bien plus encore.

Enchanté.e par votre visite ?
Veuillez nous laisser un avis Google pour nous aider à toucher plus de personnes. Merci pour le soutien ! 😊